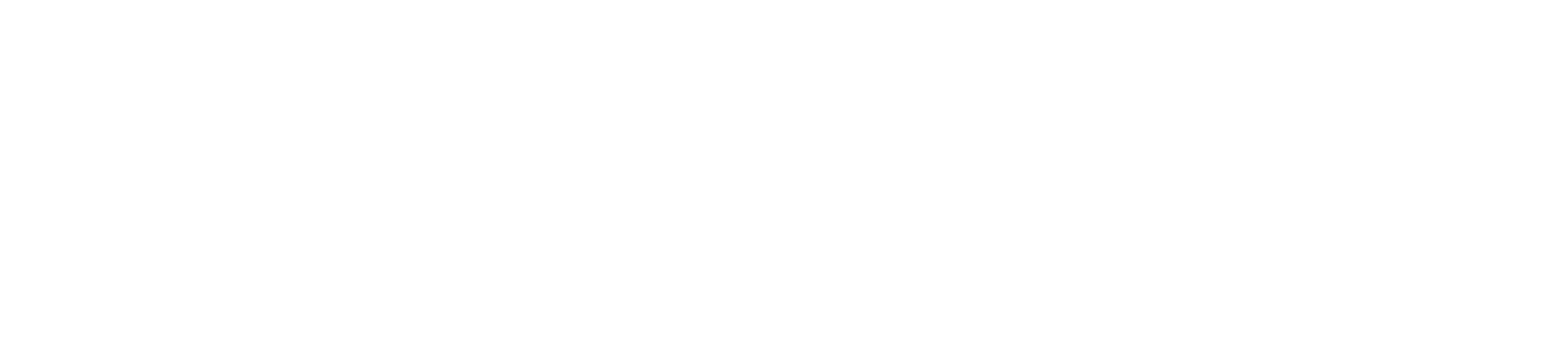DURÉE
environ 20 minutes
FORMAT
enquête + texte
Les objectifs de ce module
Reconnaître et identifier les idées préconçues sur les migrations et démystifier les principales fausses idées.
Développer une approche critique fondée sur la compréhension des différents chiffres et études relatifs aux migrations.
De quoi s’agit-il ?
Ce module te permettra d’améliorer tes connaissances et ta compréhension des chiffres, statistiques et données relatives à la migration, et te donnera les moyens d’analyser ces chiffres de manière critique. En comprenant leur signification et leurs relations, tu seras en mesure d’identifier les fausses idées sur les migrations et d’adopter une approche plus globale pour comprendre ce phénomène.

À gauche, tu trouveras un sondage composé de questions courtes. Après chaque question, tu pourras voir les résultats des votes des autres participant·es (en %). Pour permettre la collecte de ces données, saisis un pseudonyme ou un alias lorsque cela t’est demandé. Il peut s’agir d’un surnom ou d’un numéro, et il n’est pas nécessaire que ce soit ton vrai nom.
Après chaque question, tu peux consulter la réponse et obtenir plus d’informations à droite. Pour en savoir plus sur la source, réfère-toi à cette page.
Module 3 : Histoire des migrations